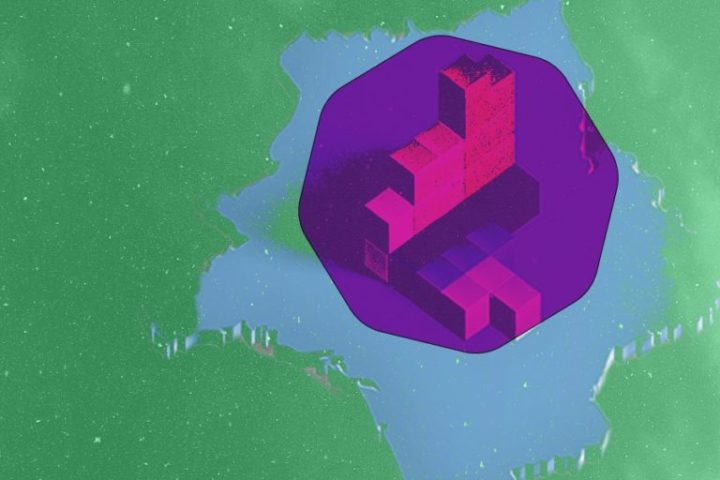Marie Cocault
étudiante en Master 2 Musées et nouveaux médias, mention Direction de projets ou d’établissements culturels à l’Université Sorbonne Nouvelle
Les musées n'ont pas de frontières,
ils ont un réseau
mars 31, 2025
Début 2023, un Musée des féminismes a été annoncé comme étant en préparation à Angers, en France. Ce musée ouvrirait ses portes dans plusieurs années ; d’abord prévue pour 2027, l’ouverture est maintenant annoncée pour 2030, sans garantie que le projet aboutisse. Cet article, au carrefour des actualités féministes et muséales, porte sur ce projet et fait état des initiatives ayant défendu la création d’un musée féministe ces 25 dernières années, et des obstacles auxquelles elles se sont confrontées.
Rôle social et politique du musée
Si le rôle social du musée est reconnu à partir des années 1930, la question du genre au musée tarde à susciter un intérêt. C’est d’abord une réflexion féministe qui prend place, notamment au travers du concept de « canon » (Nochlin 1971 ; Pollock 1981). Nochlin et Pollock soutiennent le fait de ne pas chercher à neutraliser un canon masculin par un canon féminin, qui s’encrerait dans une vision essentialiste, au risque de renforcer la distinction de genres qui leur est intrinsèque (Dumont et Sofio 2007). C’est à partir des années 1990 que l’articulation musée et genre s’établit, avec une nouvelle lecture de « l’histoire des musées, de la muséologie, de la muséographie au prisme du genre » (Foucher-Zarmanian 2018). Il s’agit alors d’aborder de manière plus globale la manière dont les institutions muséales s’inscrivent dans des dynamiques de pouvoir et participent activement à la construction et à la transmission des normes de genres.
Jean Davallon, dans les années 1990, réfléchit à la catégorisation du musée en tant que média (Davallon 1992). L’exposition, qui se veut être un outil de communication permettant « d’instaurer un rapport avec des objets ou avec des savoirs », et avec le développement des techniques qui l’accompagnent, incarne la « technologie » du musée. C’est le rapport avec les objets et les savoirs qui permettra de comprendre dans quelle mesure le musée peut être considéré comme un média. Or, les médias « participent plus que jamais à un processus de socialisation genrée » (Biscarrat et Espineira 2014).
Les femmes dans les musées
La réalisation d’expositions temporaires sur les femmes est un jalon dans leur histoire, et ces expositions fleurissent dans beaucoup de musées (musée d’histoire, d’art, d’ethnographie, etc.). Cependant, plusieurs éléments peuvent nous interroger ; les thématiques d’expositions temporaires peuvent par exemple parfois jurer avec le fonctionnement interne du musée, créant un décalage entre la thématique d’une exposition et les conditions de travail, questionnables au regard du genre (Musé.e.s 2022), mais aussi au regard du traitement de la collection. Les acquisitions et les accrochages reflètent-ils l’intérêt que les musées semblent porter aux problématiques féministes ? Il convient d’être vigilant et de se demander si les musées ne réalisent pas qu’un travail de « façade » avec les expositions temporaires et la communication développée autour de ces dernières. L’intérêt pour des œuvres réalisées par des femmes doit se manifester par les collections, la médiation, les conditions de travail, etc. Un intérêt à deux vitesses pourrait être qualifié de « feminism washing », défini comme une « Manière dont, dans leur communication, des entreprises et des structures prônent se préoccuper de l’égalité, à des fins commerciales ou d’images alors même qu’elles n’en respectent pas les valeurs au sein de leur équipe. » (HF+ Bretagne 2023).
Réseau des musées de femmes
Les musées de femmes ont évolué de façon indépendante et, souvent sans se connaître. Ils ont choisi de se développer en marge des musées « traditionnels » et ont à cœur de créer une « niche » consacrée uniquement aux cultures des femmes, à leurs histoires, leurs arts, toutes époques confondues. Aujourd’hui, les musées membres de l’International Association of Women’s Museums sont comptabilisés au nombre de soixante à travers le monde (IAWM 2023), ce qui en fait un réseau de grande envergure, dont les membres poursuivent des objectifs communs. L’IAWM a participé à l’élaboration de plusieurs expositions en collaboration avec ses partenaires, à commencer par les expositions physiques, pensées pour des lieux spécifiques ou destinées à l’itinérance.
Musées de femmes versus Musées féministes
Les musées de femmes font l’objet de débats dans les cercles féministes en raison de leur potentiel essentialiste. L’association Musé.e.s définit dans le glossaire de son Guide pour un musée féministe le terme « essentialisme » comme un « Courant de pensée selon lequel certaines qualités et comportements sont propres aux femmes et d’autres propres aux hommes. » (Musé.e.s 2022). Ce caractère potentiellement essentialiste des musées de femmes oblige à bien faire la distinction entre les musées de femmes et les musées féministes. En effet, si ces termes peuvent parfois se confondre, il est important de garder en tête qu’un musée de femmes, en fonction de son discours, n’est pas nécessairement un musée féministe.
Questions de recherche
Le champ des études féministes est un champ de recherche qui s’est révélé très dynamique durant les dernières décennies, période durant laquelle les musées ont réalisé des événements, certes toujours à la marge, au sujet des femmes, de leur histoire, et parfois même des féministes. Les luttes féministes ont entraîné des changements de pratiques au sein des musées, il convient donc de se questionner sur l’absence d’un lieu qui soit entièrement dédié à ces questions. Comment expliquer qu’en France, alors que les Musées de France sont comptabilisés à hauteur de plus de 1200, aucun d’entre eux ne soit consacré aux femmes ou aux féminismes ? Comment l’engouement international autour de ce type de musée semble avoir échappé à la France ? Ce sont ces questions qui ont dirigé ce travail vers les différents projets d’institutions féministes développés au cours des vingt-cinq dernières années. Il convient de faire un état des lieux des projets de musées féministes en France qui ont mené à la réalisation imminente du Musée des féminismes devant ouvrir ses portes à Angers dès 2030.
Ce travail s’appuie en partie sur des documents issus des fonds des lieux de collecte principaux des archives féministes en France : La contemporaine, la Bibliothèque Marguerite Durand, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, et le Centre des archives du féminisme (CAF). Ces espaces sont les seuls espaces institutionnels à être consacrés, partiellement ou entièrement, aux questions féministes.
Il s’appuie également sur cinq entretiens semi-directifs réalisés auprès de Julie Botte[1], docteure en muséologie, esthétique et sciences de l’art ; Christine Bard, historienne, présidente de l’association Archives du féminisme, responsable du musée d’histoire des femmes et du genre MUSEA ; Magali Lafourcade, docteure en droit comparé ; Nicole Pellegrin, historienne moderniste et anthropologue ; et France Chabod, bibliothécaire responsable du Centre des archives du féminisme. Les témoignages oraux constituent des données importantes car les sources écrites documentant les différents projets mentionnés ci-après sont lacunaires.
Malgré l’intérêt de la communauté scientifique et du public pour les questions de féminismes dans toutes les disciplines, et malgré l’émergence d’un réseau des musées de femmes à l’international depuis des dizaines d’années, en France, il n’y a, à ce jour, ni de musée de femmes, ni de musée consacré aux féminismes. Pourtant, plusieurs projets ont émergé durant ces vingt-cinq dernières années. Il s’agit de comprendre qui sont les acteur·ice·s de ces initiatives, leurs ambitions, leurs réflexions, et les raisons pour lesquelles certains projets n’ont pas abouti.
Cité des femmes
La Cité des femmes est une association qui émerge en 2001 et dont l’objectif est d’« élaborer un projet visant à créer un espace dédié à l’histoire des femmes et du genre, comprenant un musée ; rechercher les moyens de mettre en œuvre ce projet ; accepter dons et legs qui feront partie des collections permanentes du musée, dans l’attente de sa création » (Cité des femmes 2002). C’est Christine Bard qui en est à l’initiative. S’il s’agit du premier projet de musée féministe en France, et celui-ci est particulièrement tardif : « Des projets auraient pu être portés avant et il n’y en a pas eu, à ma connaissance. La Cité des femmes était la première association qui portait un projet de musée, un projet féministe, en tout cas, de musée » (Entretien avec Christine Bard 2024)..
Le contexte politique et social est à l’époque favorable à ce projet de Cité des femmes. Si on imagine un tel espace, c’est par continuité avec les mouvements qui ont émergé pendant les décennies précédentes. La création d’une Cité des femmes permettrait donc de stabiliser les acquis obtenus avec persévérance et de légitimer le combat féministe auprès d’un public parfois réticent. En tous cas, il limiterait autant que faire se peut un retour en arrière menaçant (Pellegrin 2024).
Le projet a été soutenu par la mairie de Paris dès ses premiers pas. Anne Hidalgo, alors première adjointe chargée de l’égalité hommes/femmes, a « chaleureusement [manifesté] son intérêt lors d’une réunion préparatoire au 8 Mars à la Mairie de Paris le 09/10/2001 » (Cité des femmes 2002). Il a été annoncé au public par Bertrand Delanoë, alors Maire de Paris. La directrice adjointe des musées de France de l’époque faisait partie du projet (Entretien avec Christine Bard 2024). Il n’y a pas eu de communication de la part de la mairie de Paris quant à l’avortement du projet de Cité des femmes. Les membres de l’association ont « constaté l’échec » et « fini par dissoudre l’association » (Entretien avec Christine Bard 2024). Nicole Pellegrin se questionne sur les objectifs qui étaient ceux d’Anne Hidalgo, se demandant notamment si ses « objectifs étaient politiciens, enfin politiques à court terme, comme beaucoup d’hommes et de femmes politiques, à partir du moment où ce n’était pas payant pour elle… » (Pellegrin 2024). Christine Bard déplore l’insuffisance de soutien politique : « Le soutien politique n’a pas été suffisant. La ville de Paris a adopté le projet et puis ensuite l’a laissé tomber » (Entretien avec Christine Bard 2024). Les difficultés à accéder à un dossier, à une documentation à propos de ce projet de Cité des femmes ne font que renforcer ces suspicions.
MUSEA
La déception à laquelle ont fait face les membres de l’association de la Cité des femmes a constitué une impulsion pour certaines d’entre elles qui se sont investies dans un projet de musée virtuel des femmes et du genre : MUSEA. Si le projet était déjà envisagé au moment de la rédaction du projet scientifique et culturel de la Cité des femmes (Bard et Trumel 2002), et qu’à la fin de l’année 2002, Christine Bard partageait leur ambition de faire de ce « cybermusée […] la préfiguration de ce futur espace de cité des femmes » (Cité des femmes 2002), il a véritablement émergé à la suite de l’abandon de la Cité des femmes. Bien qu’il s’agisse d’un projet bien distinct de la Cité des femmes, MUSEA répond à un certain nombre des objectifs de celle-ci, et notamment un accès à des informations adaptées à des publics variés. MUSEA est en ligne depuis 2004.
Cité audacieuse
La Cité audacieuse est un lieu imaginé par La fondation des femmes qui consiste en un « café engagé » dont la programmation culturelle gravite autour des questions de droits des femmes. La Cité audacieuse accueille et organise des conférences, des ateliers et des expositions. Au-dessus du café se trouvent des bureaux qui regroupent environ une cinquantaine d’associations féministes. La fondation des femmes qualifie ce lieu d’« écosystème associatif ».
Un flou persiste à propos du lien entre la Cité audacieuse et la Cité des femmes. En effet, si les projets ont peu de choses en commun, les membres de la fondation des femmes et de la Cité audacieuse affirment que la Cité audacieuse serait l’aboutissement de la Cité des femmes. Ni la mairie de Paris, ni les musées de France, ni la fondation des femmes ne sont en mesure de communiquer des informations fiables à ce sujet. Pire, les sources sont contraires : la mairie de Paris et la fondation des femmes affirment dans des échanges de mails que la Cité des femmes est le même projet que la Cité audacieuse ouverte par la fondation des femmes en mars 2020. Christine Bard, à l’origine du projet initial, affirme le contraire. Sylvie Pierre-Brossolette, chargée, pour la Fondation des femmes, de la mission de préfiguration de la Cité audacieuse, affirme que l’idée de cette « Cité des femmes » date de plusieurs années mais qu’elle va se concrétiser incessamment : « C’est l’ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, qui en avait parlé le premier. Finalement, Anne Hidalgo a repris l’idée et l’avait annoncée officiellement en fin d’année dernière. Là, c’est une priorité de la maire de Paris et ça devrait se concrétiser assez vite » (Pierre Brossolette, Tardy-Joubert 2019).
Ce flou, qui s’ajoute à celui de l’avortement du projet de Cité des femmes, est renforcé par l’absence de dossiers à la mairie de Paris et de documents sur la Cité audacieuse, et interroge notamment sur la volonté des institutions à s’impliquer réellement dans un projet féministe.
Musée des féminismes
Les demandes de visites du Centre des archives du féminisme devenant de plus en plus importantes, il a fallu imaginer un lieu qui corresponde mieux à la valorisation de ses fonds. Les travaux de la Bibliothèque universitaire du campus de Belle Beille à Angers ont offert des possibilités matérielles nouvelles, et ont permis l’émergence d’un projet de Musée des féminismes en son sein. Le Musée des féminismes incarne la pluralité, la variété des courants féministes ayant existé en France, et la richesse manifeste de la recherche féministe des dernières années (Bard et Mauduit 2023). Les progressions et acquis aussi bien techniques qu’intellectuels sont aujourd’hui ce qui permet plus que jamais d’affirmer l’intérêt d’un tel lieu (Pellegrin 2024). Pour Christine Bard, si ce projet était déjà une évidence il y a vingt ans, il l’est plus que jamais post #MeToo. Aujourd’hui, « il y a quand même une ébullition féministe un petit peu partout et qui s’est institutionnalisée aussi, il y a des politiques d’égalité dans les universités ». La période actuelle est une période propice à ce que « les universités assument pleinement leur rôle culturel et que toutes les recherches qui se font sur les femmes et le féminisme aient un débouché muséal » (Entretien avec Christine Bard 2024).
L’AFéMuse, Association pour un musée des féminismes, est créée pour soutenir la création du musée. Le gouvernement témoigne de son soutien à l’AFéMuse et intègre le projet au Plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027.
La recherche de financement est chronophage et les membres de l’AFéMuse se retrouvent une fois par semaine à ce sujet. Même si le projet a été annoncé, que le soutien du gouvernement a lui aussi été annoncé le 8 Mars 2023, l’obtention des fonds publics est compliquée : « […] on annonce que le musée fait partie du plan interministériel d’égalité entre les femmes et les hommes donc on se dit que le musée sera faisable avec des fonds publics et maintenant on essaie d’avoir ces fonds publics et c’est une autre paire de manches » (Entretien avec Christine Bard 2024). Par ailleurs, les restrictions budgétaires du gouvernement annoncées en février 2024 inquiètent Christine Bard : « Aujourd’hui je suis moins sûre que le musée soit créé tel qu’on l’a imaginé à la BU en tout cas ».
Pour investir la question de la création d’un musée féministe en France, il convient de s’appuyer sur l’émergence du mouvement féministe en son sein. Le caractère actif et dynamique des revendications féministes est en opposition avec la place qui lui est consacré dans les institutions muséales. Si le contexte a été favorable à l’institutionnalisation de l’histoire du féminisme en tant que discipline universitaire, elle ne fait pas l’objet, à ce jour, d’une institution culturelle physique. Cette absence démontre une invisibilisation des luttes féministes qui se maintient, mais il est intéressant de voir que certains pays se sont tournés vers les musées de femmes pour la contester. La question de l’intégration du féminisme au musée versus la création d’un musée consacré au féminisme se pose alors. En France, elle fait débat, et la plupart des féministes semblent plutôt se tourner vers le premier choix, se montrant quelque peu méfiantes à l’égard d’un musée « de femmes » qui pourrait servir un propos essentialisant.
Cependant, le projet du musée des féminismes semble répondre à un manque ayant fait l’objet d’une tribune dans le journal Le Monde. Alors, pourquoi un musée des féminismes est-il souhaitable ? L’état des lieux des espaces de conservation des archives féministes nous montre, d’une part, que ce sont des lieux difficiles et lents à mettre en place, en atteste le long chemin qui a mené au projet de Musée des féminismes, et nous laissent penser, d’autre part, qu’il est plus facile de faire disparaître ces espaces que d’en créer, en témoignent, cette fois, les différentes prises de position en faveur de la réduction des volumes d’archives (Vous avez dit « archives essentielles » ? 2017) et autres déménagements de bibliothèques féministes (Archives du féminisme 2017).
Cet article s’inscrit à un moment assez avancé de l’élaboration du Musée des féminismes : les multiples comités (comité opérationnel, comité de co-pilotage, comité des acquisitions et des dons, et conseil scientifique) créés au sein de l’université d’Angers et l’AFéMuse sont très actifs, l’annonce publique a été faite, et les travaux de la bibliothèque universitaire qui accueilleront le musée sont imminents (bien que l’ouverture ait récemment été décalée de 2027 à 2030). Cela dit, l’optimisme des protagonistes est tout relatif, et les craintes de certain·e·s d’entre elleux ne seront estompées que lorsque le soutien de celleux qui se sont engagé·e·s soutiendront concrètement le musée en ce qui constitue son unique possibilité de voir le jour, à savoir un soutien financier à la hauteur des besoins du projet. Il n’est pas de véritable soutien de la part du gouvernement si le financement n’en est pas le prolongement.
Note : Cet article ICOM Voices est une version éditée d’un extrait de mon mémoire de master 2 Musées et nouveaux médias mention Direction de projets ou d’établissements culturels (2024-2025) à l’Université Sorbonne Nouvelle, intitulé « Un musée à soi ? De l’absence d’un musée féministe en France », accessible ici.
Note de l’éditrice :
Références
Archives du féminisme (2017) « Sauvons la bibliothèque Marguerite Durand ! », pétition. Disponible en ligne via : https://www.archivesdufeminisme.fr/actualites/sauvons-bibliotheque-marguerite-durand/.
Bard, C. et Trumel, N. (2002) La cité des femmes : correspondance entre Christine Bard et Nelly Trumel. Femmes libres. Paris : Radio libertaire. Décembre 2002. Fonds Nelly Trumel. Centre des archives du féminisme, Angers, Bibliothèque universitaire Belle-Beille, 42AF80. Archive prêtée par Radio libertaire.
Bard, C. et Grailles, B. (2023) « Introduction », dans Les féministes et leurs archives. Presses universitaires de Rennes, p. 8.
Bard, C. et Mauduit, X. (2023) « Musée de l’histoire des féminismes, matrimonialiser les luttes », Le cours de l’histoire, France Culture, 17 mars. Durée : 59 min 54.
Belgherbi, E. (2023) « Contre-canons. Contre une histoire de l’art des héroïnes, pour une histoire de l’art des réseaux », Un carnet genre et histoire de l’art, 31 mars. Disponible en ligne via : https://ghda.hypotheses.org/2946.
Biscarrat, L. et Espineira, K. (2014) Quand la médiatisation fait genre. Transgressions et négociations de genre dans les médias. Disponible en ligne via : https://hal.science/hal-01998854.
Blais, M., Fortin-Pellerin, L., Lampron, E.-M. et Pagé, G. (2007) « Pour éviter de se noyer dans la (troisième) vague : réflexions sur l’histoire et l’actualité du féminisme radical ». Disponible en ligne via : https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2007-v20-n2-rf2109/017609ar/.
Davallon, J. (1992) « Le musée est-il vraiment un média ? », Culture & Musée, n° 2, pp. 93-123.
Dumont, F. et Sofio, S. (2007) « Esquisse d’une épistémologie de la théorisation féministe en art », Cahiers du genre, n° 43, pp. 17-43. Disponible en ligne via : https://shs.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2007-2-page-17?lang=fr.
Entretien avec Christine Bard (2024) Angers, 20 février.
Entretien avec Nicole Pellegrin (2024) 8 avril.
Fondation des femmes (2020) « La cité audacieuse », 5 mars. Disponible en ligne via : https://fondationdesfemmes.org/la-cite-audacieuse/.
Foucher Zarmanian, C. (2018) « Musées et genre : état des lieux d’une recherche », Muséologies: Les cahiers d’études supérieures, p. 3. Disponible en ligne via : https://www.erudit.org/fr/revues/museo/2016-v8-n2-museo03919/1050763ar/.
HF+ Bretagne (2023) Les inégalités de genre dans les arts et la culture en Bretagne, n°5, p. 4.
Hooks, b. (2020) Tout le monde peut être féministe. Paris : Divergences.
IAWM (2023) « The History of IAWM ». Disponible en ligne via : https://iawm.international/about-us-2/whoweare/.
Idjeraoui-Ravez, L. (n.d.) « Le musée est un média à part : langage, message, valeurs ? », dans Mairesse, F. (dir.) Définir le musée du XXIe siècle. Matériaux pour une discussion, p. 220. Disponible en ligne via : https://icofom.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/18/2018/12/LIVRE_FINAL_DEFINITION_Icofom_Definition_couv_cahier.pdf#page=222.
La cité des femmes (2002) La cité des femmes, pour un espace dédié à l’histoire des femmes et du genre. Projet culturel et scientifique associant musée, bibliothèque, archives, recherche, animations culturelles et convivialité. Paris, janvier. Archives de la Mission parité homme-femme du ministère de l’Éducation nationale (2000-2008), Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales, 20100056/2.
Lafourcade, M. (2022) « Un musée des conquêtes féministes légitimerait la place des femmes dans tous les champs des arts et de la connaissance », Le Monde, 10 mai.
Mattelart, M. (2003) « Femmes et médias. Retour sur une problématique », Réseaux, n°120, pp. 23-51. Disponible en ligne via : https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2003-4-page-23.htm.
Musé.e.s (dir.) (2022) Guide pour un musée féministe. Quelle place pour le féminisme dans les musées français ? Rennes : Association Musée.e.s.
Nochlin, L. (2021) Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? Londres : Thames Hudson.
Pierre Brossolette, S. et Tardy-Joubert, S. (2019) « Une cité pour faire rayonner les droits des femmes », Actu Juridique, 14 juin. Disponible en ligne via : https://www.actu-juridique.fr/administratif/une-cite-pour-faire-rayonner-les-droits-des-femmes/.
Parker, R. et Pollock, G. (1981) Old Mistresses: Women, Art and Ideology. London : Pandora Books.
Sommier, I. (2009) « Contre-mouvement », dans Fillieule, O., Mathieu, L. et Péchu, C. (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux. Paris : Presses de Science Po, pp. 154-160.
Université de Neuchâtel (n.d.) « Les grandes oubliées de l’Histoire ». Disponible en ligne via : https://www.unine.ch/epicene/home/explorer/invisibilisation.html.
Vous avez dit « archives essentielles » ? (2017) Les archives ne sont pas des stocks à réduire ! Elles sont la mémoire de la nation, pétition adressée au Ministère de la culture, 21 novembre. Disponible en ligne via : https://www.change.org/p/les-archives-ne-sont-pas-des-stocks-%C3%A0-r%C3%A9duire-elles-sont-la-m%C3%A9moire-de-la-nation.
[1] Julie Botte a publié un article intitulé “The National Museum of Women in the Arts and the Museum of Women: Preserving Women’s Heritage and Empowering Women” dans le numéro “Museums & Gender” de la revue Museum International. Son article est accessible ici. Les membres ICOM peuvent y accéder gratuitement via leur espace membre.